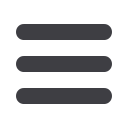

4 3
Les liens de l’AFD avec l’Union
européenne
Des difficultés du début – les premières tentatives de
délégations de gestion ont été compliquées – à la mise
en place de procédures permettant les cofinancements
avec les agences européennes d’aide et la Commission
européenne, les avancées sont considérables.
Ceci a été rendu possible par la simplification des instru-
ments européens, la mise en place d’audits auprès des
agences bilatérales permettant à celles-ci, après accré-
ditation, de mettre en œuvre des fonds européens selon
leurs propres procédures ; et l’émergence de nouvelles
modalités de financement avec les mixages prêt/don.
Ces réformes ont permis à l’UE d’augmenter les masses
d’aide publique délivrées, de moderniser les instruments
et de contribuer à la construction d’une offre euro-
péenne. Elles ont aussi favorisé un rapprochement des
acteurs européens de l’aide.
Côté AFD, ces pratiques ont progressivement amené un
changement d’échelle dans la taille des projets financés
comme dans les volumes financiers.
L’ensemble de ces relations de travail et d’échange d’ex-
périences entre acteurs européens, auxquels s’ajoutent
des relations quotidiennes entre les délégations de l’UE
et les équipes de l’AFD sur le terrain, illustrent la contri-
bution de l’Agence à cette dynamique européenne.
Enfin, il faut souligner que l’aide européenne est une
« compétence partagée », c’est-à-dire que les aides des
27 États membres coexistent aux côtés de celle de la
Commission. Tout l’enjeu est donc de trouver la bonne
allocation géographique, sectorielle et instrumen-
tale pour que ces outils communautaires et bilatéraux
produisent une valeur ajoutée au bénéfice de nos parte-
naires et bénéficiaires, que l’AFD, comme chaque acteur
bilatéral, n’aurait pu générer seule. Les efforts de tous
doivent être articulés pour que l’offre commune puisse
avoir un impact supérieur, être réductrice de coûts et
gage d’efficacité. Il s’agit donc pour la Commission, non
pas de travailler en parallèle ou d’imiter les agences
bilatérales, mais bien de collaborer avec les États
membres, en cherchant constamment à rassembler les
compétences et à rester réactif.
L’AFD à Bruxelles
Consciente de l’importance stratégique et financière de l’aide au développement communautaire (par laquelle
transitent près de 20 % de l’aide française), l’AFD a ouvert en 2002 un bureau à Bruxelles, où elle agit en coordina-
tion avec la Représentation permanente de la France auprès de l’Union.
En effet, la Commission européenne, premier donateur mondial, dont l’action couvre l’intégralité des secteurs
et zones d’intervention, est un acteur incontournable. Elle joue en outre un rôle politique, normatif et de coor-
dination. L’objectif du Bureau est simple : articuler l’action de l’AFD avec celle de la Commission. L’ AFD et ses
partenaires, notamment la KfW et la BEI, ont ainsi contribué à la création d’une véritable offre européenne de
financement, alliant prêts et dons. Cette présence depuis 10 ans à Bruxelles fait de l’AFD un acteur reconnu par
ses homologues européens, tant en termes stratégiques (apport d’expertise, organisation de débats, sensibilisa-
tion des parlementaires), qu’opérationnels – plus de 500 millions d’euros mis en œuvre pour la Commission dans
le cadre de la coopération déléguée ou des Facilités d’investissement. En 2012, le bureau de Bruxelles a intensifié
cette collaboration par sa participation au lancement de l’initiative « Énergie soutenable pour tous » (SE4ALL), son
implication dans les débats sur la Plateforme européenne de financement du développement et son concours à la
création de nouveaux instruments de financements, comme les Facilités d’investissement Caraïbes et Pacifique.
En 2012, l’AFD a engagé
2,1 milliards d’euros dans
des projets cofinancés.
Bruxelles - De gauche à droite, les représentants signataires de la KfW, la BEI et l’AFD
















