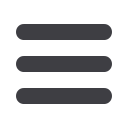
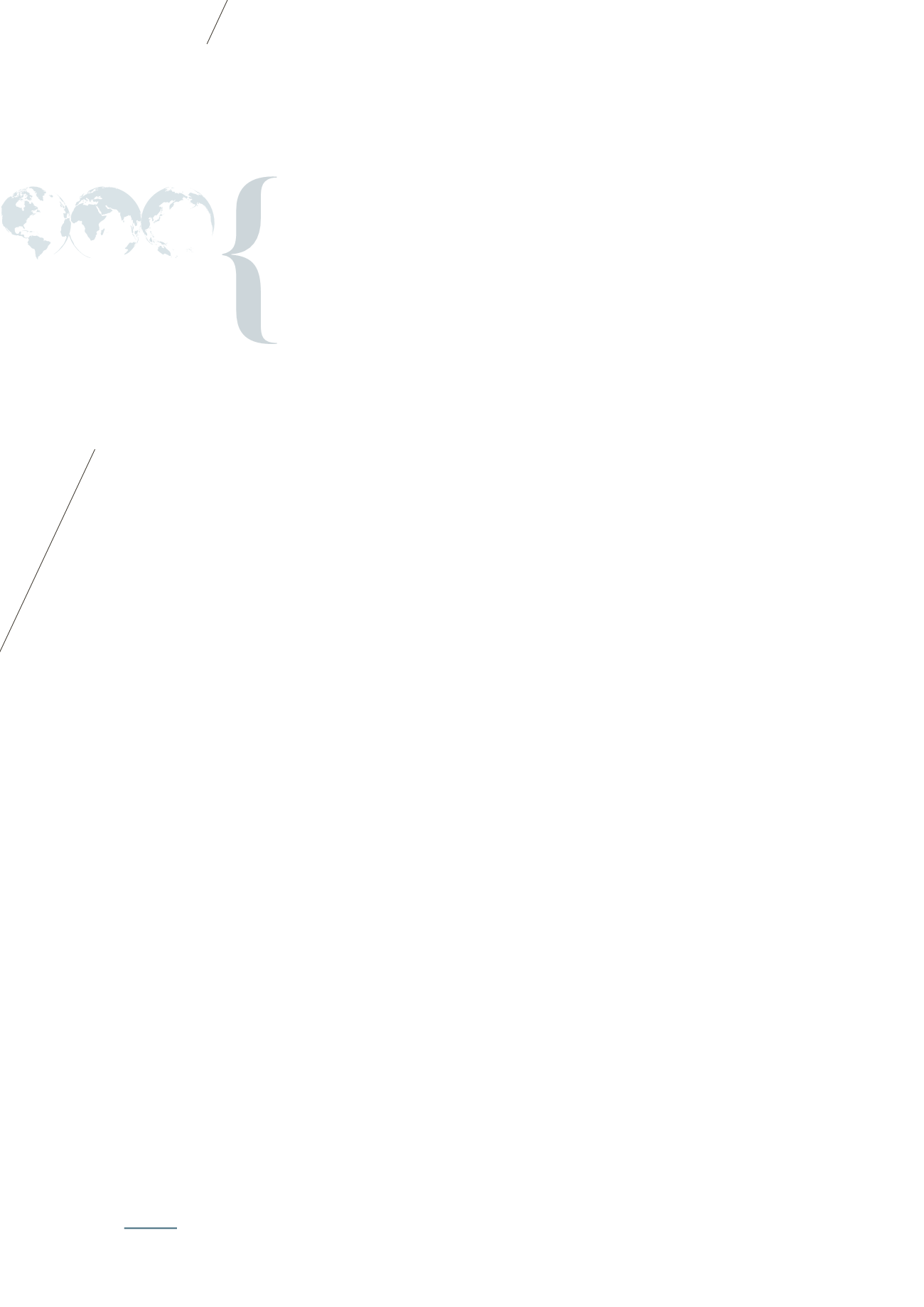
3 4
Dans les États fragiles, l’AFD soutient
des projets visant à agir sur les causes
structurelles des crises, notamment en
développant des alternatives aux économies
de guerre, en renforçant les compétences
locales et en proposant un accompagnement
psychosocial aux victimes de conflits.
En 2012, l’AFD a décidé de financer une dizaine de
projets dans des pays confrontés à des crises
1
(conflits
en cours ou en voie d’achèvement, défaillance de
l’État, catastrophes naturelles majeures), que ce soit en
Afghanistan, en Haïti, au Soudan ou dans les Territoires
autonomes palestiniens... Elle a également élargi son
périmètre d’intervention à la Birmanie, où elle finance
d’ores et déjà des projets agricoles et de développement
d’entreprises rurales.
L’ AFD n’intervient pas dans les situations d’urgence
humanitaire. Elle vise la prévention et la réduction des
facteurs de fragilité, pour renforcer la résilience des
sociétés et à accompagner la reprise des processus
de développement, et ce, essentiellement par le biais
de subventions. En 2012, sur un total de financements
autorisés de 66 millions d’euros dans ces pays, les dons
(subventions, aides budgétaires, soutien aux interven-
tions des ONG) représentent 62 millions d’euros.
Proposer des alternatives aux
économies de guerre et mafieuses
Bien que tous les projets qu’elle soutient n’aient pas
cette ambition, l’AFD vise à agir sur certaines causes
profondes des crises par ses interventions en faveur du
développement économique et social.
L’effondrement de l’appareil d’État est propice à la proli-
fération d’économies de guerre, criminelles et faites
d’activités mafieuses, de contrebandes… Ces activités
représentent aussi souvent le seul moyen de survie des
populations, dont le cheptel a été décimé, les lieux de
commerce et les voies de communication détruits…
En Afghanistan, la culture du pavot s’est développée
au gré des guerres, et la filière des opiacés représente
aujourd’hui entre 20 et 30 % du PIB. En vue d’accroître
les revenus des agriculteurs et de réduire la culture du
pavot, source de déstabilisation et de prolifération de
réseaux mafieux, l’AFD a contribué en 2005 à relancer
la culture du coton-graine dans le Nord du pays. S’il
reste encore beaucoup à faire, cette opération connaît
de très bons résultats. La production s’élève aujourd’hui
à 80 000 tonnes dans les régions de Mazâr-e Sharif et
Kunduz, contre 9 000 tonnes en 2005.
De même, au Sahel, où la croissance démographique
est forte, l’incapacité des économies à fournir un emploi
aux jeunes constitue un facteur potentiel de déstabilisa-
tion. Ces derniers fuient les campagnes et se retrouvent
dans les villes, sans perspective ni moyen d’assurer leur
subsistance, devenant alors d’idéales recrues pour les
activités criminelles et les milices politiques. Au Nord
Mali, ils vont grossir les rangs des djihadistes.
La priorité est alors de leur fournir des emplois, ce à quoi
s’attèle l’AFD en soutenant des projets de microfinance
et de formation professionnelle.
Renforcer les institutions
publiques
L’ AFD intervient également pour renforcer les capacités
des administrations publiques et des appareils d’État.
Elle finance, par exemple, un projet d’hydraulique pasto-
rale au Tchad, conduit par le ministère de l’Hydraulique,
et contribue par ce biais à l’amélioration de la gouver-
nance technique du ministère.
L’ AFD est également amenée à appuyer les États dans
leurs efforts de développement des services de base
(éducation, santé…). Au-delà de l’amélioration des condi-
tions de vie des populations, ces projets renforcent
la cohésion nationale et la légitimité des institutions,
souvent écornées par des années de conflit.
agir sur les causes
structurelles des crises
Dans
les États fragiles
A F D
L ’a c t i v i t é e n 2 0 1 2
1. 6 pays prioritaires sont plus particulièrement ciblés par le Cadre d’intervention transversal « Prévention des crises et sortie de conflit » de l’AFD qui leur octroie
des subventions. Toutefois, nombre d’autres pays sont en crise et l’AFD y intervient selon les mêmes principes d’action.
















