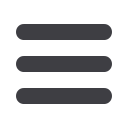

5
Quelles sont les conséquences de la politique RSE de
l’AFD en matière de politique sociale interne ?
La politique RSE de l’Agence se traduit par des avancées
sociales concrètes. L’ Agence s’est pleinement engagée
en faveur de la parité entre les femmes et les hommes.
Pour la première fois, en 2012, les femmes sont plus
nombreuses que les hommes à l’AFD. Alors qu’il y a dix
ans, seul 18 % de l’encadrement était féminin, un mana-
ger sur quatre aujourd’hui est une femme. Leur nombre
sur le terrain a fortement progressé – de moins de 10 %
en 2002 à presque 25 % aujourd’hui – et nous allons avoir
sept directrices d’agence, et huit directrices adjointes.
Fin 2012, nous avons également signé avec l’ensemble
des partenaires sociaux un accord sur l’intégration des
personnes en situation de handicap. Agréé par la Direc-
tion régionale du travail et de l’emploi, il a déjà débou-
ché sur la création d’une mission handicap et la mise en
place de formations à l’emploi des personnes en situation
de handicap.
L’ AFD a aussi signé une convention de partenariat avec
l’association « Un stage et après » qui accompagne des
collégiens issus de quartiers sensibles dans la recherche
et la préparation de leur stage de 3
e
. Elle accueillera au
moins cinq collégiens par an.
Enfin, l’Agence a renforcé son action en faveur de la
formation continue de son personnel en y consacrant une
part croissante de sa masse salariale (4,4 % fin 2012).
Comment se traduit votre priorité africaine ?
L’ Afrique subsaharienne demeure la principale zone
bénéficiaire de nos financements. En 2012, 34 % de notre
activité (hors Outre-mer) a ciblé le continent. Plus signi-
ficatif encore, l’Afrique a bénéficié des deux tiers de nos
subventions et bonifications d’intérêt. Notre action vise à
accompagner le doublement de la population du conti-
nent et le triplement de sa population urbaine, d’ici à
2050. Il faut renforcer les politiques agricoles pour nour-
rir les deux milliards d’individus que comptera le conti-
nent, et les infrastructures, pour améliorer leur accès
aux services de base comme l’eau ou l’électricité. Nous
mettons aussi l’accent sur l’éducation et sur la santé,
notamment celle des mères. C’est indispensable pour
mieux maîtriser la natalité et améliorer durablement les
conditions de vie des populations les plus pauvres. C’est
notamment dans les pays sahéliens que nous nous atta-
chons tout particulièrement à ces questions.
Où en sont les pays arabes ?
Comme nous nous y attendions, les transitions politiques
et économiques sont longues et appellent une attention
accrue de notre part. Les modèles de croissance doivent
être réorientés vers plus de création d’emplois : le seul
maintien du chômage à son niveau actuel nécessite la
création de 34 millions d’emplois en vingt ans. Un meil-
leur partage des fruits de la croissance entre toutes et
tous est nécessaire. Ces pays doivent aussi réellement
améliorer les conditions de vie des populations. Les
1,2 milliard d’euros de financement que nous avons auto-
risés en 2012 dans les pays du pourtour méditerranéen et
du Moyen-Orient visent à répondre à ces grands enjeux.
Que fait l’Agence dans les pays émergents ?
Ces dix dernières années, l’Agence a été autorisée à inter-
venir dans de nombreux pays : Brésil, Chine, Colombie,
Inde, Indonésie, Mexique, Turquie… Toutefois ces exten-
sions ne se sont pas faites au détriment de nos parte-
naires historiques. Elles sont guidées par trois principes :
ne pas avoir de coût pour l’État français, appuyer des
projets favorisant une croissance verte et solidaire, et
contribuer à la création d’un partenariat économique et
d’expertise avec ces pays.
Dans les pays émergents, nous nous sommes positionnés
sur des problématiques d’intérêt global, en particulier sur
le changement climatique : 70 % de nos financements
dans ces pays doivent avoir un effet positif sur le climat.
Nous contribuons à bâtir un langage commun avec ces
pays demandeurs de l’expérience et des savoir-faire fran-
çais en matière de développement durable.
L’ Agence semble avoir franchi un seuil dans les
Outre-mer…
C’est le cas : alors qu’historiquement notre activité se
situait autour d’un milliard, nous avons atteint 1,5 milliard
d’euros en 2012, grâce au très fort dynamisme de notre
soutien au secteur privé. L’ Agence s’affirme incontesta-
blement comme un des moteurs du développement des
territoires ultramarins. Nos financements représentent
3 % de leur PIB. Nous répondons à environ 40 % des
besoins de financement des collectivités locales. Enfin, au
travers des sept sociétés immobilières d’Outre-mer dont
nous sommes actionnaires, nous représentons la moitié
du parc de logements sociaux.
Quatre ans après le transfert du cofinancement des
initiatives des ONG, quel bilan tirez-vous ?
Il est très positif. Un rapprochement réel s’est effectué
entre les ONG et l’Agence, grâce à un effort partagé
pour mieux se comprendre. L’ AFD a beaucoup travaillé
pour mieux prendre en compte les spécificités des ONG.
Cette convergence était indispensable, pour au moins
trois raisons. La coopération d’État à État n’est pas suffi-
sante car elle ne prend pas nécessairement en compte les
aspirations des peuples ; travailler avec la société civile
permet de coller au plus près aux besoins des popula-
tions. Par ailleurs, les ONG ont la capacité d’agir dans
des contextes d’urgence dans lesquels l’AFD ne peut
intervenir. Enfin, elles sont nos intercesseurs auprès de
nos concitoyens, qui demandent à mieux comprendre les
enjeux du développement.
Au-delà des relations nouées dans le cadre des projets,
pour appuyer les initiatives des ONG sur le terrain ou
leurs actions d’éducation au développement en France,
nous associons la société civile française à l’élabora-
tion de tous nos cadres d’intervention. Avec l’objectif de
doublement de l’aide française transitant par les ONG,
cette relation organique avec les organisations de solida-
rité internationale est amenée à être encore renforcée.
L’AFD s’affirme comme
un acteur responsable de la
solidarité internationale.
















